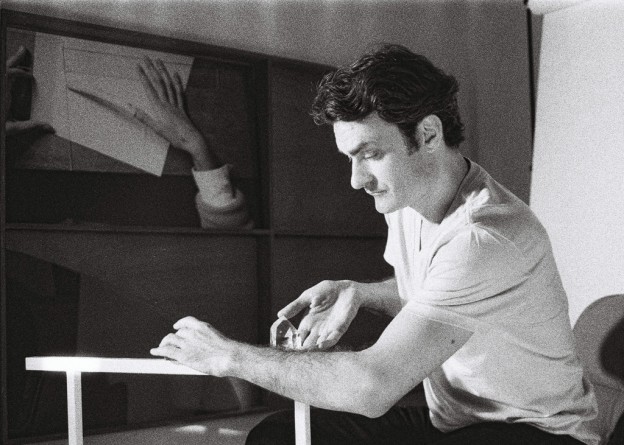Ivan Ilic, comment s’est passé votre rencontre avec la musique?
Je suis né dans une famille non pas de musiciens, mais de grands mélomanes. On allait toujours en famille, tous les quatre, en voiture, jusqu’à San Francisco, à quarante minutes, assister à des concerts, et puis, pendant les quarante minutes du retour, on discutait, on échangeait ce qu’on avait entendu. Donc c’était assez riche!
Et comment êtes-vous entré en contact avec le piano?
Comme beaucoup d’enfants, à l’écoute de ma sœur qui suivait des cours de piano depuis trois ans. Je m’y suis mis à six ans. J’avais envie, notamment à cause de Chopin. Je pense que c’est le Premier Concerto de Chopin qui m’a incité à vouloir jouer moi-même du piano.
Puis, vous avez étudié à l’Université de Berkeley en Californie. Vous avez étudié parallèlement musique et mathématiques. Est-ce qu’il y a eu une discipline qui, pendant un certain temps, aurait dominé l’autre?
À l’origine, c’étaient les maths. Sans hésitation! C’était quelque chose qui me distinguait toujours. J’étais fort en maths depuis mon enfance. Mon père a fait des études d’ingénieur. Il a un doctorat en physique. On était une famille plutôt scientifique qu’artistique. Mais c’est très intéressant, parce qu’au bout de quelques mois, à la fac, j’ai séché des cours de maths pour faire de plus en plus de piano. C’était un signe précurseur. J’ai réussi quand-même à terminer mes études de mathématiques. Dans les cours de maths, c’était assez austère: chacun pour soi, beaucoup de concurrence. En musique, on partageait beaucoup de choses. À la limite, j’apprenais encore plus de mes camarades que de mes professeurs. Et puis, évidemment, le contact avec le public est quelque chose d’unique. Je pense qu’on est né pour être sur scène ou pas. Il y a des gens qui adorent la scène, et j’en fais partie. Et ces gens-là, ils en ont besoin. C’est comme une drogue. J’adore cet équilibre entre ma vie sur scène et ma vie journalière, aussi la vie de recherche, de travail, où je suis, au contraire, très introverti, chez moi, en train de travailler le répertoire, en train de chercher les choses.
Quelle importance ont les mathématiques dans la pratique musicale?
Cela se passe à plusieurs niveaux. L’énorme avantage que m’a procuré l’étude des mathématiques, c’est que je n’ai plus peur de rien. Il faut savoir que les mathématiques de haut niveau qu’on travaille à l’université, ce n’est pas la même chose que ce qu’on apprend au lycée. Ce sont des livres très, très courts, avec une centaine de pages au maximum, et vous mettez toute l’année à comprendre cinquante pages, et encore, vous n’êtes pas sûr si vous les avez bien comprises. Cela rejoint plus la philosophie qu’autre chose. Il y des parallèles dans la musique. A une première lecture, on comprend la musique uniquement en surface. Mais pour entrer en profondeur, il y a cet effet de répétition qui est absolument primordial. Donc, à part cette idée de vaincre la peur ou le fait d’être intimidé par un sujet, ce qui était mon cas par rapport à la musique quand j’étais jeune, je dirais que l’avantage avec les mathématiques, c’est que cela structure la pensée. Il faut trouver une hiérarchie des idées. Et ça, c’est extrêmement utile en musique, parce que je vois certains de mes collègues qui n’ont pas eu ce genre de formation et qui flottent presque dans leurs propres émotions, qui leur sont seul guide, ce qui assez contraignant.
A vous entendre jouer, vous n’êtes tout de même pas un interprète purement intellectuel…
Non, je ne crois pas. Je me place plutôt parmi ceux qui jouent avec retenue. Je trouve que le peu de rubato qu’on peut se permettre dans un contexte un peu moins souple, c’est plus touchant que la musique de quelqu’un qui vous donne tout, qui se dévoile tout de suite et vous montre tout. Personnellement, sur le plan émotionnel, ça me touche moins. Mais, par contre, jouer avec retenue et donner juste un petit grain de sel de plus par moments, cette finesse m’intéresse beaucoup. C’est ce que je recherche, la finesse, le raffinement.
Après vos études en Amérique, vous êtes venu à Paris. Pourquoi Paris?
Je cherchais le défi! Je dois dire que j’étais extrêmement intimidé par Paris, par l’école française du piano, par le jeu perlé que tout le monde connaît à l’étranger. Un an avant de m’installer à Paris, j’ai présenté une bourse en Californie pour pouvoir aller étudier en Europe. J’allais à Londres et à Vienne, à Belgrade où j’ai des racines assez profondes, j’ai voyagé et France, en Allemagne, en Italie, et, finalement, j’ai assisté à un Festival Chopin à Paris, et j’ai vu plusieurs jeunes pianistes de deux, trois ans de plus que moi, avec un niveau vraiment très impressionnant. Je me suis dit : j’ai envie d’être parmi ces gens-là, j’ai envie de baigner là-dedans.
Et à Paris, vous avez eu comme professeurs Christian Ivaldi, François-René Duchâble et Jacques Rouvier, donc trois personnages très différents.
Oui, surtout sur le plan musical! Rouvier est vraiment un très, très grand pédagogue, avec plus de quarante ans d’expérience. François-René Duchâble, à l’époque, enseignait très peu. Il venait de terminer sa carrière. Il était complètement dégoûté du milieu de la musique, mais il était très, très drôle, il donnait des cours extrêmement généreux, très longs, de trois, quatre heures. J’ai absorbé beaucoup de choses de lui. Et puis, il y avait Christian Ivaldi qui est pour moi l’homme le plus élégant en musique que je connaisse. J’étais très frappé par sa façon de donner à l’élève sans essayer de l’imprégner. Il savait se mettre à distance, à bonne distance, pour nous laisser à chacun la chance d’évoluer à notre façon.
Et Duchâble, qui a jeté son piano dans un lac, vous a fait aimer un instrument qui n’est pas un Steinway, mais un Pleyel.
Absolument! Il enseignait à Annecy dans une petite école privée. Parfois, les cours dépassaient l’horaire et on continuait chez lui, dans sa grande maison. Dans le grand salon, il y avait six pianos et à chaque fois que je changeais de pièce, je changeais de piano. Il y avait un vieux Bösendorfer, un Pleyel, un Gaveau… Le Pleyel datait du début du 20e siècle et j’y ai joué les ‘Valses nobles et sentimentales’ de Ravel. Une révélation! Disposer de plusieurs instruments était une espèce de grand luxe que je me promettais de réaliser chez moi, un jour. Aujourd’hui, j’ai un Gaveau et j’ai un Pleyel, les deux de 1930, et je comprends tout à fait l’intérêt d’avoir des types de pianos différents. Sur un piano de cette époque, le répertoire contemporain devient beaucoup plus logique. Sur un grand Steinway on peut assez facilement se laisser aller, devenir brut et violent, tandis que sur un Pleyel de 1930, la violence n’existe pas vraiment. Vous pouvez faire un très fort accent et ça reste transparent. C’est incroyable. Je garde ce son dans la tête comme référence, et même quand je joue sur un Steinway, je recherche ce côté lisse et limpide.
Dans les salles de concerts vous ne rencontrez presque que des Steinway modernes…
Oui, c’est vrai, d’où l’importance de créer une idée sonore. D’ailleurs ça rejoint aussi ma formation mathématique, de pouvoir créer une idée totalement abstraite et de la poursuivre ensuite. Même si je n’ai jamais goûté au son que j’imagine, je l’imagine quand-même, je le construis dans les moindres détails, et puis, quand j’arrive sur un Steinway quelconque, je fais de mon mieux pour m’approcher de ce son.
Dans vos études, vous avez également étudié la direction d’orchestre. Est-ce que, comme tant d’autres pianistes, on va vous voir un jour sur le podium?
Alors, justement, j’en ai peur. Je ne veux pas qu’on applique sur moi cette caricature des pianistes tellement orgueilleux que le piano ne leur suffit pas. En revanche, je serais curieux de faire des tentatives au moins. Mais au-delà de Beethoven, je pense que c’est à déconseiller. A chaque fois que j’écoute des enregistrements par des pianistes qui dirigent en même temps, ça, je me dis que ça sonne toujours mieux avec un chef. [rire]. J’ai entendu récemment un très grand violoniste français qui a enregistré le Concerto de Beethoven. Et c’est vraiment quelqu’un que je respecte énormément, mais sa partie orchestrale, pour moi, n’a aucun intérêt. Le chef, ce n’est pas gratuit. C’est quelqu’un qui sert à quelque chose. J’ai étudié un tout petit peu la direction d’orchestre et je vous confirme à 100% que le chef est quelqu’un de très important.
Vous avez gagné pas mal de prix. Est-ce que vous croyez à la valeur des concours?
Moi, je pense que les concours servent à deux choses: d’une part, ils vous donnent une reconnaissance, une espèce d’encouragement, et c’est très utile pour les gens comme moi, par exemple qui ne viennent pas d’un milieu musical. Le fait que je sois reconnu par un prix ou par une belle critique, ou quelqu’un qui m’écrit un courriel après un concert, ça me donne la force de continuer, d’envisager l’avenir. Il y a beaucoup de jeunes qui surgissent, qui sont extrêmement talentueux, et malheureusement, il y en a très peu qui durent. Avoir un CV plein de louanges c’est important à une époque où de moins de moins de gens savent écouter et évaluer.
Et deuxièmement, les concours sont important pour des musiciens qui n’arrivent pas à se juger soi-même et qui ont donc ont besoin de référence extérieure.
A voir votre calendrier de concerts, je dirais que vous êtes plutôt un ‘récitaliste’.
Oui, absolument! J’adore! J’ai toujours préféré le récital, en tant que spectateur et en tant que musicien, avec ce côté très, très intime. Même dans une très grande salle, une personne qui sait créer cette intimité, cela m’a toujours excité. Je me rappelle, quand j’avais 15 ans, j’écoutais Pogorelich à San Francisco, ou Jean-Yves Thibaudet, ou Evgeny Kissin, souvent au fond de la salle de 2000 personnes, et j’avais l’impression qu’ils étaient tout près, pas physiquement, mais musicalement. Un récital vous dépayse complètement. Je trouve ça extrêmement mystérieux comme processus, et je suis passionné par ce mystère.
Il y a une pianiste qui m’a dit un jour que pour elle, le plus grand problème, c’est d’être seule sur scène. Pour vous, ce problème ne se pose-t-il pas?
Non, non, au contraire! Ma solution est extrêmement simple: il faut écouter le public, il faut, en jouant le premier morceau, écouter les bruits de la salle, parce que le public communique comme il peut. En fait, gens n’ont pas beaucoup de choix. Ils peuvent bouger leurs chaises, ils peuvent craquer leurs mains, ils peuvent se lever un petit peu, ils peuvent bouger leurs clés, tousser un petit peu pour manifester pleines de choses, pas explicites il est vrai, mais qui se ressentent quand-même. Vous sentez quand le public est avec vous, ou quand les auditeurs sont intrigués, quand ils s’ennuient, quand ils sont anxieux. D’ailleurs, cela ne doit pas correspondre à la musique. Vous pouvez jouer un mouvement lent et avoir un public anxieux. Vous pouvez jouer une pièce extrêmement virtuose et avoir un public très calme ou très silencieux. En écoutant le public, on réalise très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, je commence un morceau, et puis, j’écoute. Et ensuite, le dosage va changer, le tempo va varier. Par rapport à la répétition, le son dans la salle a changé, parce que le public est là, donc il y a un peu moins de résonance. Selon les réactions, je vais laisser un peu plus de temps entre les morceaux pour attendre, pour les laisser se calmer. Ou alors, au contraire, parfois, je les surprends: je vais m’asseoir et j’attaque le clavier tout de suite.
Est-ce que vous préférez une grande salle ou une petite?
Je pense que la taille idéale se situe entre 300 et 600 personnes. Avec moins d’auditeurs, c’est plus difficile, parfois les choses dérapent. Et au-delà de 800, je trouve on perd quelque chose. Il y a trop de gens, les gens sont trop loin, et surtout trop loin les uns des autres, c’est-à-dire que vous avez des spectateurs qui sont à plusieurs dizaines de mètres, d’autres à 3 mètres. Evidemment, il peut y avoir des gens assis dans la dernière rangée qui sont très attentifs, comme moi je l’étais quand j’étais jeune. Le problème est que, entre les gens devant la scène et ceux du fond de la salle, il n’y aucune communication, il n’y a pas l’effet de communion.
Vous avez enregistré un répertoire assez large qui va de Bach jusqu’au XXe siècle. Vous êtes donc un pianiste non spécialisé?
Oui! À chaque fois que je fais un disque qui marche un petit peu, on pense que ça y est, que j’ai une spécialité, alors que deux ans plus tard, je fais complètement autre chose. On me réclame encore aujourd’hui des concerts entiers de Godowsky, ou d’autres projets plus vieux encore. Je veux bien en faire un petit peu, mais pas un concert entier, c’est vraiment le passé pour moi. La chose la plus importante pour moi, c’est de m’enrichir, de me donner envie de continuer. Pour me donner envie de continuer, il faut que je sois enthousiaste pour un sujet. J’ai pu m’enthousiasmer pour Godowski, et ensuite pour Morton Feldman avec sa musique très abstraite, complètement le contraire de ce grand romantisme débordant de Godowsky.
Et maintenant, vous sortez un disque Feldman. Comment est-ce que vous approchez cette musique que vous ne connaissiez guère?
 Ce fut un travail monstrueux, je dois dire, notamment de lecture et de recherche. L’avantage d’Internet, c’est que vous pouvez échanger des partitions avec des gens dans le monde entier, et j’ai ainsi eu quasiment l’œuvre complète en PDFs deux semaines après le début de mes recherches. On trouve aussi des enregistrements de Feldman. Ce sont des ressources absolument incroyables. J’ai aussi voyagé. Je suis allé à Bâle, à la Fondation Paul Sacher, où il y a des manuscrits, la correspondance de Feldman, des livres rares. Je me suis informé à la médiathèque musicale Mahler à Paris. J’ai donc fait des recherches très poussées, parce que cela fait partie de ma volonté de me baigner dans tout ce que je peux trouver. Et je trouve qu’aujourd’hui, en 2015, quand on a accès à toutes ces informations, on a quelque part une responsabilité, on ne peut pas fermer les yeux. On ne peut pas faire semblant de dire que la partition, c’est tout et qu’elle suffit. Ce n’est pas vrai. Pour interpréter il faut prendre des décisions, et pour les prendre il faut chercher des raisons. La partition ne vous dit pas tout. Vous trouverez des réponses ailleurs. Et en fin de compte, cela vous donne confiance… c’est ce qu’il vous faut, lorsque vous êtes sur scène. Vous devez avoir une force de convaincre. Vous devez faire comprendre au public que ce que vous faites, vous le faites parce que vous le savez et non pas parce que vous l’avez inventé. C’est tout le travail de l’interprète: convaincre!
Ce fut un travail monstrueux, je dois dire, notamment de lecture et de recherche. L’avantage d’Internet, c’est que vous pouvez échanger des partitions avec des gens dans le monde entier, et j’ai ainsi eu quasiment l’œuvre complète en PDFs deux semaines après le début de mes recherches. On trouve aussi des enregistrements de Feldman. Ce sont des ressources absolument incroyables. J’ai aussi voyagé. Je suis allé à Bâle, à la Fondation Paul Sacher, où il y a des manuscrits, la correspondance de Feldman, des livres rares. Je me suis informé à la médiathèque musicale Mahler à Paris. J’ai donc fait des recherches très poussées, parce que cela fait partie de ma volonté de me baigner dans tout ce que je peux trouver. Et je trouve qu’aujourd’hui, en 2015, quand on a accès à toutes ces informations, on a quelque part une responsabilité, on ne peut pas fermer les yeux. On ne peut pas faire semblant de dire que la partition, c’est tout et qu’elle suffit. Ce n’est pas vrai. Pour interpréter il faut prendre des décisions, et pour les prendre il faut chercher des raisons. La partition ne vous dit pas tout. Vous trouverez des réponses ailleurs. Et en fin de compte, cela vous donne confiance… c’est ce qu’il vous faut, lorsque vous êtes sur scène. Vous devez avoir une force de convaincre. Vous devez faire comprendre au public que ce que vous faites, vous le faites parce que vous le savez et non pas parce que vous l’avez inventé. C’est tout le travail de l’interprète: convaincre!
Faire un disque, cela veut dire vendre un disque. Que dites-vous au public? Pourquoi est-ce qu’il devrait acheter ce disque?
Je dirais que la volonté d’acheter ce disque ne va pas venir ni de la pochette, ni de ce que les gens savent sur Feldman. En fait, il y a très peu de gens qui ont un culte de Feldman, qui achètent tous les disques de Feldman. Moi, je ne suis pas là pour eux et, justement, je trouve que ce qui est dommage avec ce culte de Feldman, c’est qu’il est insulaire et hermétique. Ma démarche est complètement opposée. Je veux apporter Feldman à tout le monde, et j’espère que, dans ce sens, on me fait confiance.
Mon but est que les gens me fassent tellement confiance que si demain je vais choisir un compositeur dont ils n’ont jamais entendu parler, ils vont dire: je ne connais pas ce compositeur, à priori cela ne m’intéresse pas, mais Ivan Ilic le joue et donc je suis sûr qu’il y a une histoire derrière, je suis sûr que c’est de la bonne musique si lui, il a consacré trois ans à faire ça.
Feldman est dans l’air du temps. C’est une musique sereine, abstraite, douce, extrêmement douce, elle est méditative, elle est contemplative, ce sont des choses dont on a besoin aujourd’hui. En arrivant à Paris, la première chose qui me frappe, c’est le bruit. J’ai des boules Quies dans ma poche, je les mets immédiatement et même avec les boules Quies, je suis agressé par le son. Ce n’est pas un phénomène unique, cela vaut pour toutes les villes. Vous ne pouvez pas aller dans un restaurant sans qu’il y ait du son. Vous ne pouvez pas aller dans un café sans qu’il y ait forcément de la musique. De la musique commerciale, évidemment. Et je pense que le contraire, donc la musique douce, longue, qui demande une concentration, une vraie concentration, est quelque chose dont on a besoin. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas d’émotions, mais que c’est une musique intelligente. Quand vous l’écoutez, vous ne faites rien d’autre, et elle vous comble.
Critique Pizzicato ici