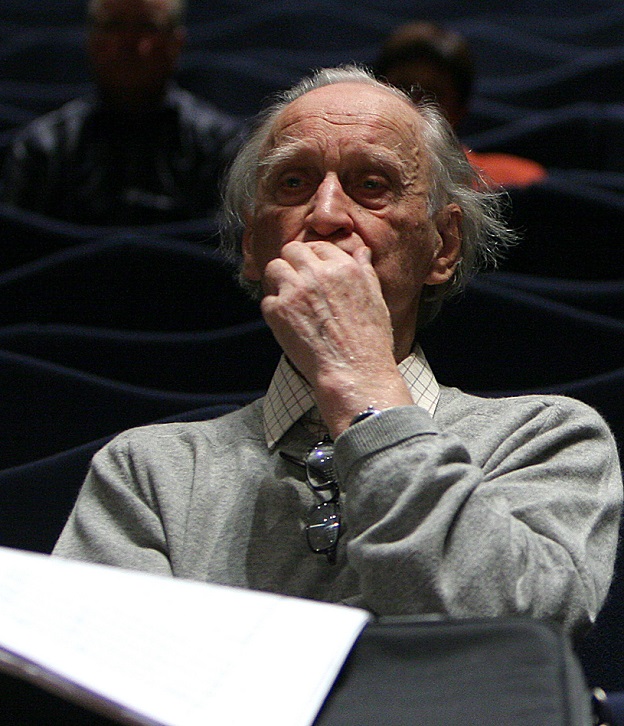Maître, votre Vibrafonietta est une œuvre de jeunesse et, en somme, peut-être pas trop caractéristique de votre oeuvre en général…
C’est vrai, c’est à la fois une oeuvre de jeunesse et, comment dirais-je, une réparation d’une faute de jeunesse. Je l’ai composée en 1960, à une période ou je suis passé d’un monde musical à l’autre. J’ai changé complètement sous les effets de mon arrivée en France. Plus tard, je considérai cette pièce tout à coup comme faible, au point que je l’ai oubliée. Mais, il y a quelques ans, un percussionniste voulait absolument la jouer. Alors je lui ai promis de regarder la pièce. J’ai étudié la partition et je lui ai dit: ‘Ecoutez Monsieur, ça ne va pas, oubliez cette œuvre!’ Mais comme il insistait, j’ai corrigé un peu par ici et un peu par là, mais sans en être satisfait. Alors je me suis mis à retravailler la partition complètement et je l’ai pratiquement refaite à partir de quelques éléments que je considérai comme étant bons. J’ai complètement réécrit la partie du vibraphone, parce que, entre 1960 et aujourd’hui, les percussions ont probablement fait le plus grand progrès sur le plan instrumental, le plus grand de tous les instruments, et je devais en tenir compte. Il est vrai qu’il me fallait recomposer la pièce dans le style de l’époque sans introduire autre chose, ce qui fait que je la considère maintenant comme une pièce qui ne me représente pas, mais que je peux signer sans rougir.
Lors de votre séjour en France, vous l’avez déjà dit, vous avez complètement changé. Pourquoi?
Depuis mon adolescence et les études que j’ai faites à Zagreb, j’ai toujours été porté vers la modernité que je n’ai pas pu ni recevoir comme enseignement ni exprimer en tant que compositeur dans un pays qui été assez stalinien à l’époque. C’était l’idéologie qui régnait, et quand je suis venu en France, j’étais foudroyé par tout ce que j’ai vu et entendu autour de moi. Peu à peu, par les différentes découvertes et notamment par la musique électroacoustique qui était extrêmement importante dans ma vie, j’ai commencé à changer complètement et cela, je pense, dans le bon sens. Je n’ai pas changé ma nature, j’ai changé seulement la façon de l’exprimer authentiquement.
Vous êtes donc passé d’un mode de composition traditionnel à une musique qui utilisait l’électronique. N’aviez-vous jamais le sentiment de ne plus être aussi libre qu’avant, d’être lié à un studio? Vous ne pouviez plus vous mettre sur un banc dans un parc pour écrire votre musique…
Pas du tout! Ma liberté, au contraire, a augmenté. D’un côté j’ai continué à écrire des œuvres sans intervention électronique. D’un autre côté, la musique électroacoustique m’a appris à écouter et à inventer des sons. Cette expérience que j’ai acquise dans le studio électroacoustique, je l’ai appliquée dans ce que j’appelle mon studio instrumental. Et en fin de compte, je suis plutôt un compositeur de musique écrite que de musique électroacoustique.
Pourtant, votre catalogue montre que vous avez, dans tous les genres – musique orchestrale, instrumentale, vocale – un faible pour la composition mixte. Comment abordez vous une œuvre mixte utilisant une bande magnétique et des instruments? Est-ce que vous préparez d’abord la bande ou écrivez-vous d’abord la musique des instruments?
Cela dépend. Tout commence par une image acoustique dans l’oreille. Puis, je me pose des questions sur ce que j’ai dans l’oreille. C’est quoi cette nouvelle oeuvre, quelle est sa personnalité? Il faut que ce personnage s’installe dans mon corps et alors c’est lui qui me dicte le choix des matériaux. Généralement, tout ce passe alors en même temps, au studio et en écriture. Parfois, c’est l’un qui avance, puis l’autre, mais on ne peut pas imaginer la musique mixte comme étant une rencontre de deux choses différentes. C’est un ensemble au moment de la création et un ensemble au moment de l’exécution. Pour moi, c’est un travail parallèle et extrêmement impliqué l’un dans l’autre.
Quand vous écrivez une telle oeuvre mixte la relation entre les instruments et la bande magnétique est donc très cohérente?
Disons que la relation est organique. Dans un concerto pour percussion et bande magnétique il m’est arrivé d’obtenir un son que je développais dans des séquences très longues. Parallèlement, je travaillais à la partition, mais sans vraiment avancer. Je n’avançais pas et je n’avançais pas parce que j’étais convaincu que ce que je faisais était le début de l’œuvre. Un jour j’ai capté dans la tête une pensée, un message d’un autre monde qui me disait que c’était la fin et non pas le début de la pièce, et à partir de ce moment là, tout allait très vite. Donc, si vous me demandez comment je travaille, c’est difficile d’y répondre. C’est un processus extrêmement mystérieux dans lequel, d’après moi, le compositeur n’est jamais seul. Lorsqu’il compose il a toute la matière musicale en face qui, elle, a ses exigences. Il faut donc se parler et puis mettre les choses ensemble pour qu’elles puissent commencer à vivre. Il n’y a pas de méthode, moi je travaille plutôt avec les messages que je reçois.
Vous avez dit que les percussions ont fait un grand progrès au cours des dernières 30/40 ans, est-ce que vous ressentez aussi ce progrès dans l’informatique que vous utilisez probablement?
Pour être tout à fait sincère: je travaille peu dans le numérique dans le sens où on travaille aujourd’hui. Aujourd’hui, je vois mes camarades, la tête devant l’écran. Mais ce n’est pas à l’écran qu’on compose. L’œuvre ne sort pas de l’écran. D’ailleurs, il y a beaucoup de gens qui considèrent que l’ère de l’oeuvre est terminée, mais moi je pense que l’oeuvre reste le seul cadre dans lequel tout se règle. La liberté de la création est la liberté de la pensée. L’émotion, l’existence, tous les problèmes musicaux sont confinés dans l’oeuvre qui est la chose la plus libre au monde, et l’informatique est tout au plus un moyen de travail, mais pas de pensée.
Vous avez dit que vous avez changé totalement d’attitude de composition dans les années soixante. Est-ce que depuis vous avez encore changé? On a souvent dit que, au cours des dernières années, votre musique est devenue plus contemplative…
Au lieu de ‘changer’ j’utiliserai plutôt le mot ‘compléter’. J’ai vécu – heureusement d’ailleurs – à une époque très difficile et assez brutale, où les règlements de compte étaient à l’ordre du jour. Parfois cela se passait bien, souvent c’était maladroit sinon stupide. Mais c’était une époque de grande transformation, c’était une sorte de grand tremblement de terre dans la musique. Pour beaucoup, la dimension lyrique qu’on pouvait avoir et que je croyais avoir, n’avait pas de place, peut-être parce qu’il y avait d’autres urgences. Moi aussi je me suis retenu dans un certain sens. Tout cela est devenu un passé plus ou moins glorieux, et tout d’un coup je me suis dit: Mais il y a des choses que tu n’as pas encore dites, qui sont en toi, dans la contemplation, dans le lyrisme, des aspects qui sont alors sortis, mais sortis sur la base de toutes les expériences que j’ai pu vivre auparavant.

Photographiés en 2004: Ivo Malec & Olivier Frank, alors directeur artistisque de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg
(c) OPL/Hurlin
Aujourd’hui, vos œuvres sont beaucoup jouées. Vous vous êtes spécialement déplacé à Luxembourg. Est-ce que vous allez à beaucoup de concerts où on joue vos compositions?
Vous savez, c’est bizarre: il y a des années où tout vous arrive, il y a des concerts qui se suivent, vous êtes joué un peu partout et puis, pendant deux ans, il n’y a pas grand chose ou pratiquement rien. L’année 2003 était extrêmement fructueuse pour moi. J’avais beaucoup de concerts et même deux concerts monographiques à Paris. Cela continue au début de cette année, mais ça va s’arrêter d’ici quelque temps. Oui, si je peux, je vais volontiers écouter les interprétations de mes œuvres. Et comment aurai-je pu refuser de venir à Luxembourg? Luxembourg, c’est ma terre, j’y ai mon ami Olivier Frank et j’ai des très beaux souvenirs, notamment de mon concerto pour violon qui m’a été commandé par la Ville de Luxembourg. Et puis cela ne s’arrête pas là parce qu’à la rentrée nous faisons un disque ensemble, sous la direction de Maître Tovey. Pour moi, être à Luxembourg, c’est toujours un moment de bonheur.